Les Paradis artificiels. Charles Baudelaire.10
Voilà donc mon homme supposé, l’esprit de mon choix, arrivé à ce degré de joie et de sérénité où il est contraint de s’admirer lui-même. Toute contradiction s’efface, tous les problèmes philosophiques deviennent limpides, ou du moins paraissent tels. Tout est matière à jouissance. La plénitude de sa vie actuelle lui inspire un orgueil démesuré. Une voix parle en lui (hélas ! c’est la sienne) qui lui dit : « Tu as maintenant le droit de te considérer comme supérieur à tous les hommes ; nul ne connaît et ne pourrait comprendre tout ce que tu penses et tout ce que tu sens ; ils seraient même incapables d’apprécier la bienveillance qu’ils t’inspirent. Tu es un roi que les passants méconnaissent, et qui vit dans la solitude de sa conviction : mais que t’importe ? Ne possèdes-tu pas ce mépris souverain qui rend l’âme si bonne ? »
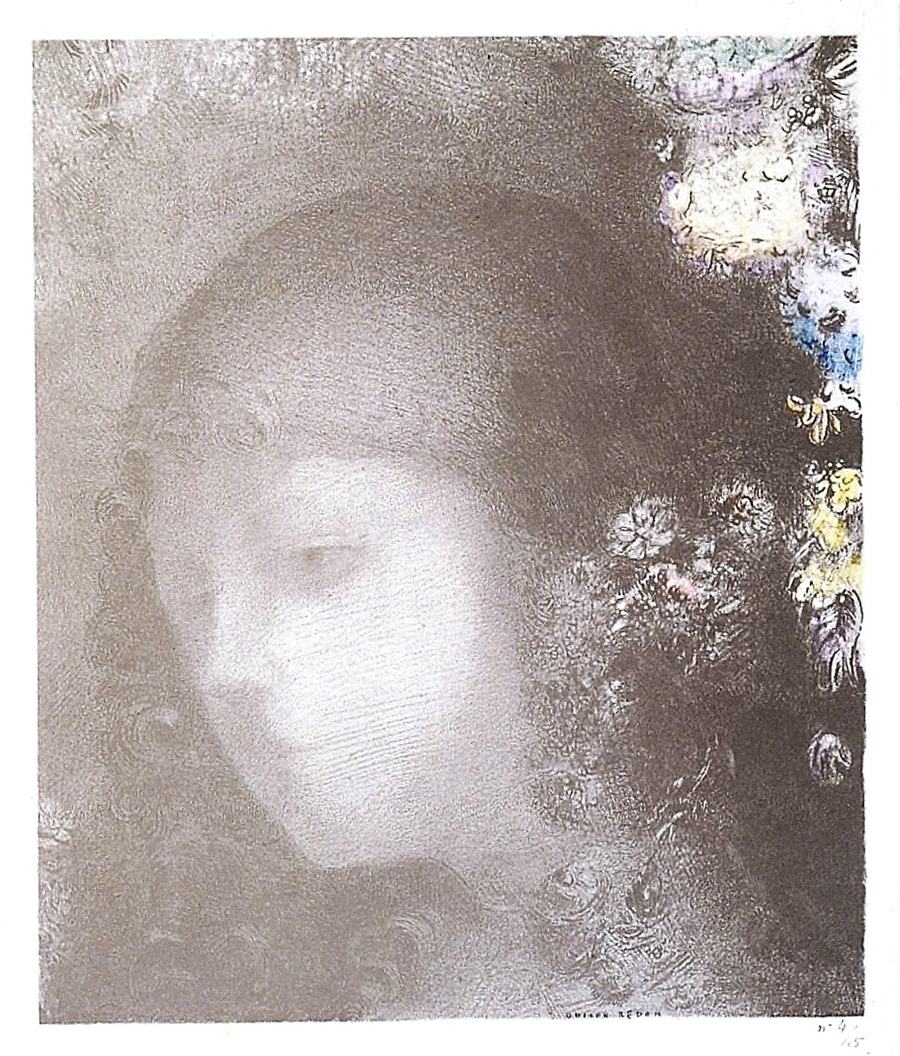
Cependant nous pouvons supposer que de temps à autre un souvenir mordant traverse et corrompe ce bonheur. Une suggestion fournie par l’extérieur peut ranimer un passé désagréable à contempler. De combien d’actions sottes ou viles le passé n’est-il pas rempli, qui sont véritablement indignes de ce roi de la pensée et qui en souillent la dignité idéale ? Croyez que l’homme au haschisch affrontera courageusement ces fantômes pleins de reproches, et même qu’il saura tirer de ces hideux souvenirs de nouveaux éléments de plaisir et d’orgueil. Telle sera l’évolution de son raisonnement : la première sensation de douleur passée, il analysera curieusement cette action ou ce sentiment dont le souvenir a troublé sa glorification actuelle, les motifs qui le faisaient agir alors, les circonstances dont il était environné, et s’il ne trouve pas dans ces circonstances des raisons suffisantes, sinon pour absoudre, au moins pour atténuer son péché, n’imaginez pas qu’il se sente vaincu ! J’assiste à son raisonnement comme au jeu d’un mécanisme sous une vitre transparente : « Cette action ridicule, lâche ou vile, dont le souvenir m’a un moment agité, est en complète contradiction avec ma vraie nature, ma nature actuelle, et l’énergie même avec laquelle je la condamne, le soin inquisitorial avec lequel je l’analyse et je la juge, prouvent mes hautes et divines aptitudes pour la vertu. Combien trouverait-on dans le monde d’hommes aussi habiles pour se juger, aussi sévères pour se condamner? » Et non seulement il se condamne, mais il se glorifie. L’horrible souvenir ainsi absorbé dans la contemplation d’une vertu idéale, d’une charité idéale, d’un génie idéal, il se livre candidement à sa triomphante orgie spirituelle. Nous avons vu que, contrefaisant d’une manière sacrilège le sacrement de la pénitence, à la fois pénitent et confesseur, il s’était donné une facile absolution, ou, pis encore, qu’il avait tiré de sa condamnation une nouvelle pâture pour son orgueil. Maintenant, de la contemplation de ses rêves et de ses projets de vertu, il conclut à son aptitude pratique à la vertu ; l’énergie amoureuse avec laquelle il embrasse ce fantôme de vertu lui paraît une preuve suffisante, péremptoire, de l’énergie virile nécessaire pour l’accomplissement de son idéal. Il confond complétement le rêve avec l’action, et son imagination s’échauffant de plus en plus devant le spectacle enchanteur de sa propre nature corrigée et idéalisée, substituant cette image fascinatrice de lui-même à son réel individu, si pauvre en volonté, si riche en vanité, il finit par décréter son apothéose en ces termes nets et simples, qui contiennent pour lui tout un monde d’abominables jouissances : « Je suis le plus vertueux de tous les hommes ! »
Cela ne vous fait-il pas souvenir de Jean-Jacques, qui, lui aussi, après s’être confessé à l’univers, non sans une certaine volupté, a osé pousser le même cri de triomphe (ou du moins la différence est bien petite) avec la même sincérité et la même conviction? L’enthousiasme avec lequel il admirait la vertu, l’attendrissement nerveux qui remplissait ses yeux de larmes, à la vue d’une belle action ou à la pensée de toutes les belles actions qu’il aurait voulu accomplir, suffisaient pour lui donner une idée superlative de sa valeur morale. Jean-Jacques s’était enivré sans haschisch.
Suivrai-je plus loin l’analyse de cette victorieuse monomanie ? Expliquerai-je comment, sous l’empire du poison, mon homme se fait bientôt centre de l’univers ? comment il devient l’expression vivante et outrée du proverbe qui dit que la passion rapporte tout à elle ? Il croit à sa vertu et à son génie ; ne devine-t-on pas la fin ? Tous les objets environnants sont autant de suggestions qui agitent en lui un monde de pensées, toutes plus colorées, plus vivantes, plus subtiles que jamais et revêtues d’un vernis magique. « Ces villes magnifiques, se dit-il, où les bâtiments superbes sont échelonnés comme dans les décors, — ces beaux navires balancés par les eaux de la rade dans un désœuvrement nostalgique, et qui ont l’air de traduire notre pensée : Quand partons-nous pour le bonheur ? — ces musées qui regorgent de belles formes et de couleurs enivrantes, — ces bibliothèques où sont accumulés les travaux de la science et les rêves de la Muse, — ces instruments rassemblés qui parlent avec une seule voix, — ces femmes enchanteresses, plus charmantes encore par la science de la parure et l’économie du regard, — toutes ces choses ont été créées pour moi, pour moi, pour moi !
Pour moi, l’humanité a travaillé, a été martyrisée, immolée, — pour servir de pâture, de pabulum, à mon implacable appétit d’émotion, de connaissance et de beauté ! » Je saute et j’abrège. Personne ne s’étonnera qu’une pensée finale, suprême, jaillisse du cerveau du rêveur : « Je suis devenu Dieu ! », qu’un cri sauvage, ardent, s’élance de sa poitrine avec une énergie telle, une telle puissance de projection, que, si les volontés et les croyances d’un homme ivre avaient une vertu efficace, ce cri culbuterait les anges disséminés dans les chemins du ciel : « Je suis un Dieu ! » Mais bientôt cet ouragan d’orgueil se transforme en une température de béatitude calme, muette, reposée, et l’universalité des êtres se présente colorée et comme illuminée par une aurore sulfureuse. si par hasard un vague souvenir se glisse dans l’âme de ce déplorable bienheureux : N’y aurait-il pas un autre Dieu ? croyez qu’il se redressera devant celui-là, qu’il discutera ses volontés et qu’il l’affrontera sans terreur. Quel est le philosophe français qui, pour railler les doctrines allemandes modernes, disait : « Je suis un dieu qui a mal dîné ? » Cette ironie ne mordrait pas sur un esprit enlevé par le haschisch ; il répondrait tranquillement : « Il est possible que j’aie mal dîné, mais je suis un Dieu. »
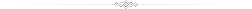
Mais le lendemain ! le terrible lendemain ! tous les organes relâchés, fatigués, les nerfs détendus, les titillantes envies de pleurer, l’impossibilité de s’appliquer à un travail suivi, vous enseignent cruellement que vous avez joué un jeu défendu. La hideuse nature, dépouillée de son illumination de la veille, ressemble aux mélancoliques débris d’une fête. La volonté surtout est attaquée, de toutes les facultés la plus précieuse. On dit, et c’est presque vrai, que cette substance ne cause aucun mal physique, aucun mal grave, du moins. Mais peut-on affirmer qu’un homme incapable d’action, et propre seulement aux rêves, se porterait vraiment bien, quand même tous ses membres seraient en bon état ? Or, nous connaissons assez la nature humaine pour savoir qu’un homme qui peut, avec une cuillerée de confiture, se procurer instantanément tous les biens du ciel et de la terre, n’en gagnera jamais la millième partie par le travail. Se figure-t-on un État dont tous les citoyens s’enivreraient de haschisch ? Quels citoyens ! quels guerriers ! quels législateurs !
Même en Orient, où l’usage en est si répandu, il y a des gouvernements qui ont compris la nécessité de le proscrire. En effet, il est défendu à l’homme, sous peine de déchéance et de mort intellectuelle, de déranger les conditions primordiales de son existence et de rompre l’équilibre de ses facultés avec les milieux où elles sont destinées à se mouvoir, en un mot, de déranger son destin pour y substituer une fatalité d’un nouveau genre. souvenons-nous de Melmoth, cet admirable emblème. son épouvantable souffrance gît dans la disproportion entre ses merveilleuses facultés, acquises instantanément par un pacte satanique, et le milieu où, comme créature de Dieu, il est condamné à vivre. Et aucun de ceux qu’il veut séduire ne consent à lui acheter, aux mêmes conditions, son terrible privilège. En effet, tout homme qui n’accepte pas les conditions de la vie, vend son âme. Il est facile de saisir le rapport qui existe entre les créations sataniques des poëtes et les créatures vivantes qui se sont vouées aux excitants. L’homme a voulu être Dieu, et bientôt le voilà, en vertu d’une loi morale incontrôlable, tombé plus bas que sa nature réelle. C’est une âme qui se vend en détail.
Balzac pensait sans doute qu’il n’est pas pour l’homme de plus grande honte ni de plus vive souffrance que l’abdication de sa volonté. Je l’ai vu une fois, dans une réunion où il était question des effets prodigieux du haschisch. Il écoutait et questionnait avec une attention et une vivacité amusantes. Les personnes qui l’ont connu devinent qu’il devait être intéressé. Mais l’idée de penser malgré lui même le choquait vivement. On lui présenta du dawamesk ; il l’examina, le flaira et le rendit sans y toucher. La lutte entre sa curiosité presque enfantine et sa répugnance pour l’abdication se trahissait sur son visage expressif d’une manière frappante. L’amour de la dignité l’emporta. En effet, il est difficile de se figurer le théoricien de la volonté, ce jumeau spirituel de Louis Lambert, consentant à perdre une parcelle de cette précieuse substance.