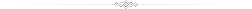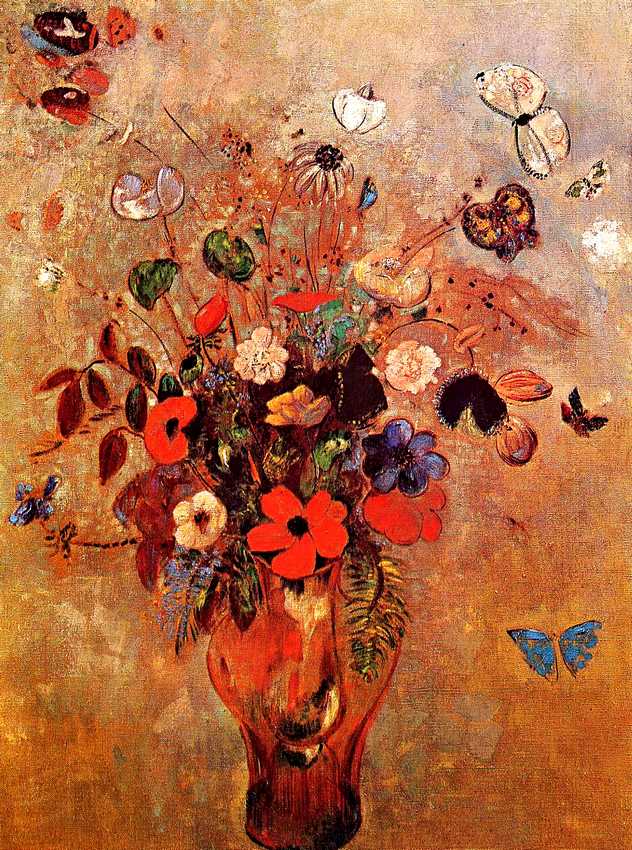Les Paradis artificiels. Charles Baudelaire.27
Le front était bien le même, mais les paupières glacées, les lèvres pâles, les mains roidies le frappèrent horriblement ; et pendant qu’immobile il la regardait, un vent solennel s’éleva et se mit à souffler violemment, « le vent le plus mélancolique, dit-il, que j’aie jamais entendu. » Bien des fois, depuis lors, pendant les journées d’été, au moment où le soleil est le plus chaud, il a ouï s’élever le même vent, « enflant sa même voix profonde, solennelle, memnonienne, religieuse. » C’est, ajoute-t-il, le seul symbole de l’éternité qu’il soit donné à l’oreille humaine de percevoir. Et trois fois dans sa vie il a entendu le même son, dans les mêmes circonstances, entre une fenêtre ouverte et le cadavre d’une personne morte un jour d’été.
Tout à coup, ses yeux, éblouis par l’éclat de la vie extérieure et comparant la pompe et la gloire des cieux avec la glace qui recouvrait le visage de la morte, eurent une étrange vision. Une galerie, une voûte sembla s’ouvrir à travers l’azur, — un chemin prolongé à l’infini. Et sur les vagues bleues son esprit s’éleva ; et ces vagues et son esprit se mirent à courir vers le trône de Dieu ; mais le trône rayait sans cesse devant son ardente poursuite. Dans cette singulière extase, il s’endormit ; et quand il reprit possession de lui-même, il se retrouva assis auprès du lit de sa sœur. Ainsi l’enfant solitaire, accablé par son premier chagrin, s’était envolé vers Dieu, le solitaire par excellence. Ainsi l’instinct, supérieur à toute philosophie, lui avait fait trouver dans un rêve céleste un soulagement momentané. Il crut alors entendre un pas dans l’escalier, et craignant, si on le surprenait dans cette chambre, qu’on ne voulût l’empêcher d’y revenir, il baisa à la hâte les lèvres de sa sœur et se retira avec précaution. Le jour suivant, les médecins vinrent pour examiner le cerveau ; il ignorait le but de leur visite, et, quelques heures après qu’ils se furent retirés, il essaya de se glisser de nouveau dans la chambre ; mais la porte était fermée et la clef avait été retirée. Il lui fut donc épargné de voir, déshonorés par les ravages de la science, les restes de celle dont il a pu ainsi garder intacte une image paisible, immobile et pure comme le marbre ou la glace.
Et puis vinrent les funérailles, nouvelle agonie ; la souffrance du trajet en voiture avec les indifférents qui causaient de matières tout à fait étrangères à sa douleur ; les terribles harmonies de l’orgue, et toute cette solennité chrétienne, trop écrasante pour un enfant, que les promesses d’une religion qui élevait sa sœur dans le ciel ne consolaient pas de l’avoir perdue sur la terre. À l’église on lui recommanda de tenir un mouchoir sur ses yeux. Avait-il donc besoin d’affecter une contenance funèbre et de jouer au pleureur, lui qui pouvait à peine se tenir sur ses jambes ? La lumière enflammait les vitraux coloriés où les apôtres et les saints étalaient leur gloire ; et, dans les jours qui suivirent, quand on le menait aux offices, ses yeux, fixés sur la partie non coloriée des vitraux, voyaient sans cesse les nuages floconneux du ciel se transformer en rideaux et en oreillers blancs, sur lesquels reposaient des têtes d’enfants, souffrants, pleurants, mourants. Ces lits peu à peu s’élevaient au ciel et remontaient vers le Dieu qui a tant aimé les enfants. Plus tard, longtemps après, trois passages du service funèbre, qu’il avait entendus certainement, mais qu’il n’avait peut-être pas écoutés ou qui avaient révolté sa douleur par leurs trop âpres consolations, se représentèrent à sa mémoire, avec leur sens mystérieux et profond, parlant de délivrance, de résurrection et d’éternité, et devinrent pour lui un thème fréquent de méditation. Mais, bien avant cette époque, il s’éprit pour la solitude de ce goût violent que montrent toutes les passions profondes, surtout celles qui ne veulent pas être consolées. Les vastes silences de la campagne, les étés criblés d’une lumière accablante, les après-midi brumeuses, le remplissaient d’une dangereuse volupté. Son œil s’égarait dans le ciel et dans le brouillard à la poursuite de quelque chose d’introuvable, il scrutait opiniâtrément les profondeurs bleues pour y découvrir une image chérie, à qui peut-être, par un privilège spécial, il avait été permis de se manifester une fois encore.
C’est à mon très-grand regret que j’abrége la partie, excessivement longue, qui contient le récit de cette douleur profonde, sinueuse, sans issue, comme un labyrinthe. La nature entière y est invoquée, et chaque objet y devient à son tour représentatif de l’idée unique. Cette douleur, de temps a autre, fait pousser des fleurs lugubres et coquettes, à la fois tristes et riches ; ses accents funèbrement amoureux se transforment souvent en concetti. Le deuil lui-même n’a-t-il pas ses parures ? Et ce n’est pas seulement la sincérité de cet attendrissement qui émeut l’esprit ; il y a aussi pour le critique une jouissance singulière et nouvelle à voir s’épanouir ici cette mysticité ardente et délicate qui ne fleurit généralement que dans le jardin de l’Église romaine. — Enfin une époque arriva, où cette sensibilité morbide, se nourrissant exclusivement d’un souvenir, et ce goût immodéré de la solitude, pouvaient se transformer en un danger positif ; une de ces époques décisives, critiques, où l’âme désolée se dit : « Si ceux que nous aimons ne peuvent plus venir à nous, qui nous empêche d’aller à eux ? » où l’imagination, obsédée, fascinée, subit avec délices les sublimes attractions du tombeau. Heureusement l’âge était venu du travail et des distractions forcées. Il lui fallait endosser le premier harnais de la vie et se préparer aux études classiques.
Dans les pages suivantes, cependant plus égayées, nous trouvons encore le même esprit de tendresse féminine appliqué maintenant aux animaux, ces intéressants esclaves de l’homme, aux chats, aux chiens, à tous les êtres qui peuvent être facilement gênés, opprimés, enchaînés. D’ailleurs, l’animal, par sa joie insouciante, par sa simplicité, n’est-il pas une espèce de représentation de l’enfance de l’homme ? Ici donc, la tendresse du jeune rêveur, tout en s’égarant sur de nouveaux objets, restait fidèle à son caractère primitif.
Il aimait encore, sous des formes plus ou moins parfaites, la faiblesse, l’innocence et la candeur. Parmi les marques et les caractères principaux que la destinée avait imprimés sur lui, il faut noter aussi une délicatesse de conscience excessive, qui, jointe à sa sensibilité morbide, servait à grossir démesurément les faits les plus vulgaires, et à tirer des fautes les plus légères, imaginaires même, des terreurs malheureusement trop réelles. Enfin, qu’on se figure un enfant de cette nature, privé de l’objet de sa première et de sa plus grande affection, amoureux de la solitude et sans confident. Arrivé à ce point, le lecteur comprendra parfaitement que plusieurs des phénomènes développés sur le théâtre des rêves ont dû être la répétition des épreuves de ses premières années. La destinée avait jeté la semence ; l’opium la fit fructifier et la transforma en végétations étranges et abondantes. Les choses de l’enfance, pour me servir d’une métaphore qui appartient à l’auteur, devinrent le coefficient naturel de l’opium. Cette faculté prématurée, qui lui permettait d’idéaliser toutes choses et de leur donner des proportions surnaturelles, cultivée, exercée longtemps dans la solitude, dut à Oxford, activée outre mesure par l’opium, produire des résultats grandioses et insolites même chez la plupart des jeunes gens de son âge.
Le lecteur se rappelle les aventures de notre héros dans les Galles, ses souffrances à Londres et sa réconciliation avec ses tuteurs. Le voici maintenant à l’Université, se fortifiant dans l’étude, plus enclin que jamais à la songerie, et tirant de la substance dont il avait fait, comme nous l’avons dit, connaissance à Londres à propos de douleurs névalgiques, un adjuvant dangereux et puissant pour ses facultés précocement rêveuses. Dès lors, sa première existence entra dans la seconde, et se confondit avec elle pour ne faire qu’un tout aussi intime qu’anormal. Il occupa sa nouvelle vie à revivre sa première. Combien de fois il revit, dans les loisirs de l’école, la chambre funèbre où reposait le cadavre de sa sœur, la lumière de l’été et la glace de la mort, le chemin ouvert à l’extase à travers la voûte des cieux azurés ; et puis, le prêtre en surplis blanc à côté d’une tombe ouverte, la bière descendant dans la terre, et la poussière rendue à la poussière ; enfin, les saints, les apôtres et les martyrs du vitrail, illuminés par le soleil et faisant un cadre magnifique à ces lits blancs, à ces jolis berceaux d’enfants qui opéraient, aux sons graves de l’orgue, leur ascension vers le ciel ! Il revit tout cela, mais il le revit avec variations, fioritures, couleurs plus intenses ou plus vaporeuses ; il revit tout l’univers de son enfance, mais avec la richesse poétique qu’y ajoutait maintenant un esprit cultivé, déjà subtil, et habitué à tirer ses plus grandes jouissances de la solitude et du souvenir.